Maurice Couturier, « Nabokov ou La tentation française »
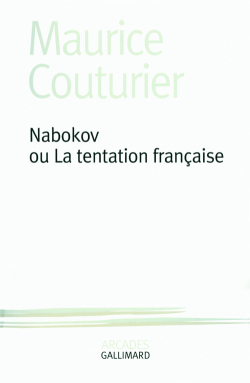
Le récent essai que Maurice Couturier a consacré à Vladimir Nabokov porte (une nouvelle fois) un titre évocateur : Nabokov ou La tentation française, que Bernard Pivot a ainsi traduit avec humour : « Nabokov avec nous ! » (Journal du dimanche, 22 octobre 2011).
Maurice Couturier nous y invite à explorer la richesse des relations que Nabokov a entretenues avec la France et sa littérature. Avec, bonheur supplémentaire pour tout amateur de l’œuvre de Vladimir Nabokov, la réédition du premier texte, intitulé « Les écrivains et l’époque » (1931), que Vladimir Nabokov, alors jeune écrivain émigré russe qui signait Vladimir Sirine, a écrit directement en français et dont Maurice Couturier indique, avec raison, qu’ « il contient en filigrane les principaux éléments de sa
poétique ».
Maurice Couturier, Nabokov ou La tentation française, Paris, Gallimard, coll. « Arcades », 2011.
Nabokov, l’auteur de Lolita, a prétendu qu’il aurait pu être « un grand écrivain français ». Les vicissitudes de l’histoire en ont décidé autrement. Le mirage de la Côte d’Azur est omniprésent tout au long de ce roman paru pour la première fois en France, où il fut censuré. Grand admirateur de Ronsard, Flaubert ou Verlaine, Nabokov était passionnément attaché à la langue française, plus douce à son oreille que sa langue maternelle, le russe, et que sa langue d’adoption, l’anglais. Le mot français « plaisir » lui semblait distiller un « supplément de vibrato spinal » par rapport à son équivalent anglais. Non seulement choisit-il de passer les dernières années de sa vie en Suisse, à Montreux, une ville francophone, mais, tel un phalène attiré par la lumière, il ne cessa jamais de revenir en France.
Bernard Pivot, « Nabokov avec nous ! », Le Journal du dimanche, 22 octobre 2011
La dernière fois que Vladimir Nabokov est venu en France, c’était à Paris, en mai 1975, pour Apostrophes. Ainsi achevait-il une longue fréquentation commencée avec sa mère en 1901 – il n’avait que deux ans et demi –, puis en 1903 et 1907, sur la Côte d’Azur et à Biarritz. En 1919, fuyant la révolution bolchevique, c’est à Marseille qu’il débarqua avec toute sa famille. L’exil serait désormais son pays.
Éditeur de Nabokov dans la Pléiade, parfait connaisseur de la vie et de l’œuvre du grand écrivain russe, traducteur entre autres de Lolita, Maurice Couturier dresse l’inventaire « de tout ce qui rattache ce génial auteur, souvent érotique, toujours raffiné et éminemment cultivé, à la France et à la culture française ». Titre de cet essai qui, tant j’admire l’écrivain, m’a passionné : Nabokov ou La tentation française. Oui, tenté, aimanté, séduit par la langue et la littérature françaises dont Mademoiselle, sa gouvernante à Saint-Pétersbourg, lui avait enseigné les richesses et donné le goût. Toute sa vie Nabokov a été un lecteur enthousiaste et savant de Flaubert et de Proust. Aux étudiants américains il en exposait les subtilités de l’écriture. S’il n’aimait pas Corneille, Racine, Voltaire, Marivaux, ou bien ses contemporains, Sartre, Camus et Malraux – dans ses refus il était impitoyable –, il vouait une grande admiration à Ronsard, Diderot, Chénier, Chateaubriand, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Queneau, etc. D’un caractère bien trempé il n’était pas homme à suivre les modes de la critique ou de l’université.
Quand il a décidé de ne plus écrire dans la langue russe, Nabokov aurait pu choisir le français. Probablement y a-t-il songé. D’autant qu’avant la Seconde Guerre mondiale, il habitait depuis trois ans en France. Il y avait vécu une ardente passion extraconjugale. Les exilés russes le considéraient déjà comme un écrivain majeur et Jean Paulhan, influent dirigeant de la NRF, était de ses amis. Mais c’est à Paris qu’il a écrit son premier roman en anglais, La Vraie Vie de Sebastian Knight. Quand les Allemands envahirent la France, il embarqua pour New York. Maurice Couturier montre bien que l’anglais était plus apte à « se plier à la luxuriance de son imagination baroque que le français bridé par sa syntaxe tyrannique et sa relative pauvreté lexicale ». Nabokov disait que le russe était la langue de son cœur, l’anglais de son esprit et le français de son oreille. Acteur, il eût joué dans notre langue, je suppose. Quelle connaissance il avait du français! Je l’ai vu en colère contre l’un de ses traducteurs parce qu’il ignorait un mot qu’il lui avait suggéré. « Émile l’emploie », me dit-il. Devant mon air perplexe, il lança, agacé : « Émile Littré ! »
Maurice Couturier se demande si Lolita, quoique écrit en anglais, ne devrait pas être admis « au panthéon de la littérature française ». Parce qu’il a été publié en France pour la première fois. Parce que c’est à Paris que Nabokov eut « le frisson d’inspiration initial ». C’est encore à Paris que Humbert Humbert découvre son irrésistible attirance pour les nymphettes. En Amérique, lorsque Lolita lui apparaît, elle lui rappelle Annabel, sa « petite amie de la Côte d’Azur », région de France que Nabokov fréquentait avec bonheur, le Sud ayant toujours été le terrain d’élection du collectionneur de papillons. Enfin, le narrateur et vil séducteur Humbert Humbert est un francophone. C’est pourquoi le texte de Lolita est truffé d’expressions et de mots français, choisis pour ajouter à la trouble sensualité de l’histoire. La France n’est-elle pas le pays des libertins ? Quant au prénom Lolita, il est devenu un nom féminin commun. Une lolita désigne une nymphette. Au pluriel, des lolitas, précise Le Petit Robert qui n’a pas froid aux yeux.
Eric Chevillard, Le Monde, 3 novembre 2011 [extrait]
« Dans le passionnant essai qu’il consacre à ses rapports avec la France et sa littérature, Nabokov ou La tentation française, Maurice Couturier relate une histoire tissée de rencontres miraculeuses et de pénibles malentendus. Éternel exilé, Nabokov finira sa vie à Montreux, retournant étrangement le destin de la gouvernante suisse, égarée dans la vieille Russie, qui lui enseigna notre langue en lui lisant Les Malheurs de Sophie et Le Comte de Monte-Cristo. L’écrivain rendra à celle-ci un hommage cruel et tendre dans l’unique nouvelle qu’il écrivit en français, Mademoiselle O, dont le brio aurait en effet de quoi faire rougir bien des écrivains nationaux consacrés (oui, c’est un peu agaçant). »
